Journal des Forges – épisode 1
L’année 2017 commence, l’occasion de prendre de bonnes résolutions, même pour une maison d’édition.
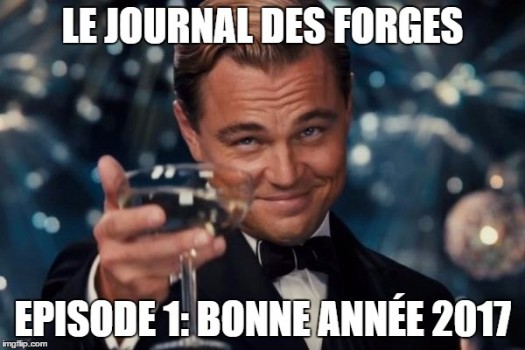
“Who’ll be the lady, who will be the lord
When we are ruled by the love of one another
Who’ll be the lady, who will be the lord
In the life that is coming in the morning”
Sing John Ball, par Sydney Carter
Une nouvelle année commence et elle semble plus politique que d’autres. La proximité des élections présidentielles françaises, tout comme les retombées du Brexit et de l’élection de Donald Trump, donnent son sujet à l’année qui vient. L’édition comme la presse vont ruminer ce sujet, du moins pendant la première partie de l’année. Mais ce qui distingue l’édition de la presse, dans leur contribution à la conversation collective, c’est sa temporalité plus longue. D’une part, un livre nécessite plus de temps de préparation qu’un article de presse. D’autre part, il est difficile de faire un livre sans espérer que sa résonnance dépassera les quelques semaines de sa publication. Cette double contrainte impose à l’éditeur ou l’éditrice de choisir ses textes bien avant leur date de publication, et de leur donner une profondeur qui survivra à l’actualité brûlante. Par rapport au travail de la presse, cela revient à un avantage et une difficulté. Difficulté : au moment de leur sortie, certains livres sont déjà inactuels, au plus mauvais sens du terme – ils n’existeront jamais car ils épousent une mode déjà dépassée. Avantage : l’éditeur et l’éditrice sont contraints de réfléchir à ce qui est vraiment important, dans notre actualité, ce qui structure la figure de notre monde.
Bien sûr, on pourrait considérer cet exercice d’actualité comme vain, et considérer que les textes doivent toujours être inactuels. Soit que l’on considère que l’importance d’un texte apparaisse seulement à sa postérité lointaine. Soit que l’on considère que le monde et les lettres doivent restés dissociés, que le monde est le lieu de la corruption, et les lettres le berceau de la pureté. A ceux et celles qui écrivent pour la postérité, rappelons que la postérité n’est souvent possible que si un texte, lors de sa publication s’est, même très modestement, inscrit dans la conversation collective. A ceux et celles qui conspuent le monde, on peut répondre, d’une part, que, même si les textes sont des œuvres de l’esprit, les corps qu’occupent ces esprits sont bien vivants, et, d’autre part, que dissocier les lettres du monde revient à sanctifier une impuissance des lettres face au monde. Affirmer le besoin d’inscrire les textes dans le monde, c’est aussi un moyen d’affirmer que les mots changent le monde. Ou, du moins, qu’ils changent les personnes et que les personnes changent le monde.
Il peut sembler grandiloquent d’affirmer vouloir changer le monde. Peut-être que nous sommes trop marqués par les grands films d’aventure, où les héros doivent sauver le monde en deux heures. Tout d’abord, vouloir changer le monde ne signifie nullement que l’on pense qu’on le changera effectivement. Contrairement aux héros, nous ne sommes pas assurés de réussir. Ensuite, contrairement aux héros, encore, nous détenons rarement le pouvoir de changer radicalement le monde – mais nous possédons le pouvoir de le changer petitement. De toute façon, nos actions quotidiennes changent le monde, que nous le désirions ou non. Pour sentir cela, il suffit de songer à cette idée, que l’on prête à un célèbre moine japonais, Ikkyū Sōjun : à l’instant où je prononce un mot avec colère, j’ouvre devant moi les portes de l’enfer, à l’instant où je fais acte de gentillesse, j’ouvre les portes du paradis. L’image est belle – avec cette réserve que ce que cet adepte du zen entendait par « enfer » et « paradis » est sans doute très différent que ce que nous, nous entendons par ces mots. C’est un appel à se concentrer sur les moyens de nos actions, car nos moyens nous appartiennent, et moins sur les effets de nos actions, qui dépendent peu de nous.
Un livre fait la ligne, plus que la ligne ne fait le livre
Quand on est une maison d’édition, l’attention aux moyens peut se comprendre à deux niveaux. Sur la manière de pratiquer le métier. Et sur les textes que l’on choisit. Sur la pratique du métier, je crois être encore assez novice, et commettre encore trop d’erreurs, pour écrire quoi que ce soit. Par contre, je peux parler du choix des textes. Bien que ce ne soit pas très visible, les Forges sont une maison politique et ce, même s’il est sans doute difficile, même pour le lecteur ou la lectrice qui nous suit avec fidélité, de savoir quelle serait l’appartenance politique des Forges. D’ailleurs, je ne connais pas les opinions politiques de tous les auteurs des Forges et, pour celles que je connais, elles sont variées.
Donc, les Forges ne sont pas une maison politique au sens classique du terme : nous n’avons pas de ligne politique explicite. Ce refus volontaire d’une ligne est lié à deux éléments. Premièrement, les Forges sont une petite maison et, comme toute petite maison, leur identité est très liée à la personnalité de ses fondateurs. Or, les fondateurs des Forges, s’ils ont bien des valeurs politiques, n’adhérent pas à une idéologie politique particulière (ce n’est pas là une critique en creux de la notion d’idéologie, mais simplement un fait – qui d’ailleurs, relève du fait social et générationnel : les idéologues semblent moins nombreux aujourd’hui qu’il y a trente ans). Deuxièmement, en examinant notre absence d’idéologie, et la pratique éditoriale des maisons qui conservent une identité idéologique forte, il m’est apparu que, trop souvent, l’affichage nette d’une couleur politique servait à se faire voir d’un petit groupe d’amis, mais condamnait souvent à un entre soi stérile politiquement.
Ainsi, alors que la présidence de Barack Obama vit ses dernières heures, il est possible de voir que ses quelques succès et son usage de la conversation collective devaient beaucoup à une approche à la fois consensuelle et radicale de la communauté – une approche qui lui a été inspirée à la fois par son rôle de « community organizer » à Chicago, et par la lecture des textes de Saul Alinsky, que l’on présente parfois comme le créateur du métier de « community organizer ». A l’inverse des « liberals » (une partie du parti démocrate américain) qui professaient avec radicalité des idées consensuelles, Alinsky se fixe comme règle de professer de manière consensuelle des idées radicales. En termes stratégiques, je suppose que les Forges sont des élèves d’Alinsky : toute personne est notre amie en puissance, et nous travaillons avec la certitude qu’un changement radical du monde est possible, à condition de créer des larges consensus, au-delà des attaches idéologies de chacun. En un sens, derrière les moyens, les Forges ont bien des fins en tête.
Mais, alors que le début d’année est un moment de réflexion sur les moyens et les fins que nous pourrions poursuivre en cette année particulièrement politique, la question demeure : quelles sont les fins politiques des Forges ?
Ce que les livres nous disent
Je suppose que professer des fins serait sans doute possible, mais la lecture des textes d’Alinsky me rend prudent : après tout, professer des fins est parfois un moyen de les réaliser symboliquement et de se dire que le travail est déjà fait alors, que, concrètement, rien n’a été fait. Peut-être vaut-il mieux considérer que professer publiquement des fins ne peut que provoquer des alliances bancales, des inimitiés sans objet – des jeux narcissiques et stériles. Et peut-être vaut-il se fixer cette règle, que les actions doivent parler pour nous – ce qui signifie, pour une maison d’édition, laisser les livres parler. Bien plus : ce sera un jeu de piste, en cette nouvelle année, pour nos lecteurs, que de deviner nos fins.
Je m’en voudrais toutefois de vous laisser sans un début de piste. Ce billet qui, si je suis sérieux, sera le premier d’une série régulière, s’est ouvert sur une citation. Ces quatre vers sont les premières paroles d’une chanson de Sydney Carter, célèbre poète britannique, qui a écrit cet hymne à l’approche des commémorations des cinq cents ans de la mort de John Ball. John Ball était un esclave qui, devenu prêtre, mena la révolte des paysans du Kent contre le roi et sa cour, en 1381, en sa qualité de « community organizer » avant l’heure, et avec un sermon dont quelques mots, comme un cri de ralliement, sont restés : « Quand Adam bêchait et Ève filait, où donc était le gentilhomme ? ». Cette figure de John Ball a inspiré à William Morris un bref roman historique et politique : Un rêve de John Ball. Les Forges ont publié la première traduction française de ce texte, réalisée par Marion Leclair.
Donner ce texte à lire aux lecteurs français, c’était l’occasion, à la fois de faire découvrir William Morris par son angle « politique », mais aussi un moyen de faire connaître John Ball, ce héros peu connu en France, à la fois prêtre catholique et leader politique. D’ailleurs, le John Ball de William Morris a une parenté avec le Jésus de Nazareth de Paul Verhoeven : refus de l’autorité, foi indéfectible en la communauté amicale comme fondement de la communauté politique. – Oui, finalement, pour avoir des premières pistes sur la politique des Forges, il suffit de lire. Lire Un Rêve de John Ball de William Morris. Lire Jésus de Nazareth de Paul Verhoeven. Lire Désobéir en démocratie de Manuel Cervera-Marzal. Lire La Source au bout du monde de William Morris. Lire Notre règne arrivera de Grace Lumpkin.
Les Forges vous souhaitent une année pleine de lectures, d’amitié et d’idéalisme.
Tweeter