L’illusion de Frankenstein #viedelediteur
Premier épisode de la série #viedelediteur
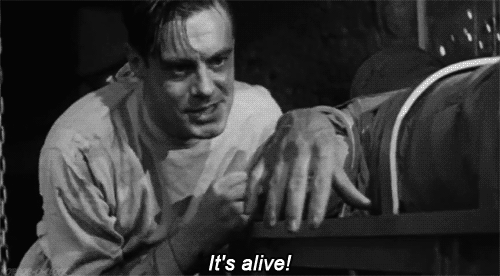
Il est souvent difficile d’écrire et de nombreux écrivains en herbe ont du mal à jeter le peu qu’ils ont écrit. C’est compréhensible, dans la mesure où ces rares pages ont été comme arrachées à l’impossibilité d’écrire. Impossible car : pas le temps, pas l’inspiration, pas la concentration, etc.
Mais que faire quand on veut écrire et qu’on écrit trop peu, de manière fragmentée, disséminée ? Eh bien, il suffit de faire de la couture, de coller entre eux ces morceaux épars dans l’espoir que l’assemblage leur donnera un semblant de vie.
Mais le résultat de ces patchworks est rarement heureux et leurs auteurs semblent tombés sous le coup de l’illusion de Frankenstein – cette illusion du savant qui, voulant créer la vie, a créé un semblant de vie, l’apparence de la vie, mais pas la vie, en collant ensemble des morceaux, mais sans percevoir que la vie n’est pas un assemblage mais un développement méthodique et progressif d’une étincelle initiale.
Cette illusion de Frankenstein donne existence à deux types de fictions cabossées. D’un côté, les fictions à bons mots. De l’autre côté, les fictions à bonnes idées.
Les fictions à bons mots : l’auteur, sensible aux petits bonheurs du langage, a trouvé quelques formules heureuses, qu’il tient absolument à conserver. Il construit son récit, ou ses pages, autour. A la lecture, ces textes se trahissent parfois dès la première page, où commencent à fleurir des mots rares qui semblent comme arrachés au Littré des provinces. Si la première page ne les a pas démasqués, les pages suivantes le feront, tant il est difficile de faire tenir un roman sur si peu. Comme le disait Faulkner, il faut tuer ce genre de trésors – il ne faut pas s’illusionner sur ce qu’ils apportent au texte.
Les fictions à bonnes idées : l’auteur, pendant des années, a pris en note sur un carnet la totatlité des bonnes idées qu’il avait, jour après jour. Peu à peu, cela fait beaucoup de pages qui ont été noircies clandestinement et l’auteur transforme son roman en une sorte d’arche de Noé, où chaque idée devient un animal rare qu’il faut, à tout prix, caser dans ce fier vaisseau – sinon, il sera perdu à tout jamais. A la fin, son œuvre n’a aucune unité organique, mais ressemble à une juxtaposition de choses qui, en elles-mêmes, sont piquantes, mais, côte à côte, donnent l’impression de former une fiction en kit, qu’il appartiendrait au lecteur de monter, avec, dans une main, un manuel, dans l’autre, ce petit tournevis tordu dont seuls les Suédois savent à quoi il peut bien servir.
Dans les deux cas, que cela se joue dans les mots ou dans les idées, l’illusion de Frankenstein est à l’œuvre. Comme elle est à l’œuvre dans la plupart des mauvaises comédies. La plupart des mauvaises comédies ne sont que des blagues ou sketches que leurs auteurs cherchent à faire tenir ensemble. A l’inverse, les comédies les plus connues sont structurées comme un drame, avec une vraie histoire, de vrais enjeux narratifs, et les gags ou blagues sont inventés après coup, pendant l’écriture. Au fur et à mesure, et s’inscrivent dans la narration – comme dans Un jour sans fin.
D’ailleurs, employer le mot « invention » n’est pas anodin mais rappelle que l’écriture est une expérience et une exploration. En un sens, les auteurs victimes de l’illusion de Frankenstein manquent de confiance en eux, manquent de confiance en leur capacité d’exécution – ils refusent de croire qu’ils puissent partir sans rien, d’une feuille blanche, et avancer, et, en avançant, trouver et inventer au fur et à mesure.
L’illusion de Frankenstein est la révélation d’un manque de familiarité avec l’écriture, d’un manque d’engagement, non pas moral, mais simplement matériel. Si on écrit beaucoup, on finit par se libérer de la peur de perdre des bons mots, de bonnes idées – on finit par savoir que l’on sait faire, que l’on trouvera bien, et, qu’on découvrira faisable le chemin en le faisant.
Des remarques, des suggestions? Rendez-vous sur la page Facebook des Forges!
Tweeter